


ORGUES DE PARIS © 2025 Vincent Hildebrandt ACCUEIL LES ORGUES
Opéra Garnier
Place de l'opéra, 75009 Paris
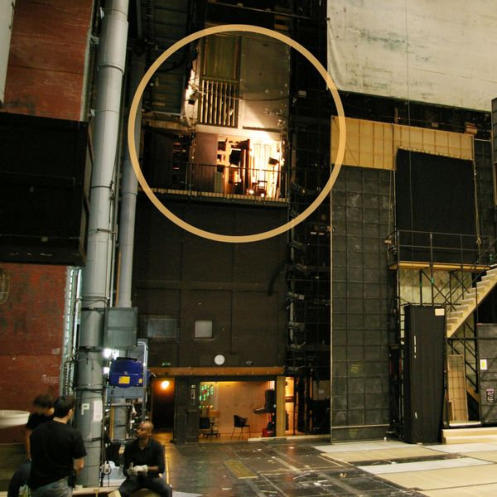

E6
Beaucoup ignorent que l’Opéra de Paris possède un
instrument construit par Cavaillé-Coll en 1874.
Ce dernier est totalement invisible aux yeux du grand public
puisqu’il est situé côté Cour au niveau de l’avant-scène avec
des tuyaux à 12 mètres de hauteur.
Il s’agit d’un orgue de 14 jeux (sans compter 4 emprunts à la
pédale) répartis sur deux claviers de 56 notes et d’un pédalier
de 30 notes entièrement fermé dans une boite expressive.
L’inauguration a lieu le 8 janvier 1875 avec la représentation
de la « Juive » de Fromental Halévy. Dès ce moment, l’orgue fut
utilisé de façon régulière au gré des représentations d’œuvres
requérant son usage.
Cependant, l’instrument eu à souffrir rapidement de la
poussière provoquée par le montage des décors sur la scène
ainsi que des écarts de températures très grands. Un premier
cri d’alerte lancé en 1893 par Cavaillé-Coll lui-même qui
remarque que son instrument n’a jamais été dépoussiéré. Par
la suite, l’état de l’orgue se détériore encore, certains jeux
souffrent d’une perte de qualité de leur timbre, si bien que
Cavaillé considéra l’orgue « en état de délabrement » en 1894!
En 1925, suite à une fuite dans la colonne d’eau du service
incendie, l’orgue fut inondé et mis hors de service. Suite à cet
incident, la maison Cavaillé-Coll / Convers fut appelée à
effectuer une restauration de l’instrument qui fut gratifiée de
quelques modifications, a plus importante étant l’installation
d’ un ventilateur électrique, installé dans une pièce séparée
située sous l’orgue.
Cet instrument fut utilisé pour la dernière fois le 23 mars 1959
pour célébrer le centenaire de la création de Faust par Charles
Gounod. Les claviers sont tenus par l'organiste André Marchal.
Il le joua encore occasionnellement en 1964. Depuis 1974,
l'orgue est devenu injouable et subit les malversations visibles,
surtout à la console. En revanche, la tuyauterie d'origine
subsiste intacte. Cet orgue est conservé dans son
emplacement d'origine voulu par son constructeur, ce qui est
unique dans son genre.
Informations de Timothy Tikker (facebook):
L’orgue était sur la pression du vent de 8’’ et 10’’, et je crois l’orgue
n’avait pas de levier pneumatique. Les fortes pressions étaient
principalement parce que l’orgue a été placé loin en coulisses - les
orgues de cinéma placés dans les coulisses ayant aussi peu de
rangs par rapport à la taille de la salle utilisaient ces mêmes
pressions. La console était située avec les tuyaux, Cavaillé-Coll
faisant remarquer que l’orgue a été conçu pour le plaisir du
public, pas de l’organiste! Le joueur pouvait voir le chef d’orchestre
à l’aide d’une série de miroirs soigneusement placés.
Il est question de sa restauration depuis 2012.
THE PARIS OPERA'S CAVAILLE-COLL ORGAN
Rollin Smith, The American organist


Cet opéra a été appelé « opéra de Paris » jusqu'en
1989, date à laquelle l'ouverture de l'opéra Bastille,
également opéra de Paris, a influé sur son
appellation. On le désigne désormais par le seul
nom de son architecte : « opéra Garnier » ou «
palais Garnier ». Les deux opéras sont aujourd'hui
regroupés au sein de l'établissement public à
caractère industriel et commercial « Opéra national
de Paris », institution publique française dont la
mission est de mettre en œuvre la représentation
de spectacles lyriques ou de ballet, de haute qualité
artistique. Sur une conception de l’architecte
Charles Garnier retenue à la suite d’un concours, sa
construction, décidée par Napoléon III dans le cadre
des transformations de Paris menées par le préfet
Haussmann a été interrompue par la guerre de
1870 et fut reprise au début de la Troisième
République, après la destruction par incendie de
l’opéra Le Peletier en 1873. Le bâtiment a été
inauguré le 5 janvier 1875 par le président Mac
Mahon sous la IIIe République.

L’enregistrement
S'il est devenu injouable depuis 1974, une poignée
d'enregistrements en gardent la trace sonore. Le
plus célèbre d'entre eux est le Faust enregistré en
1953 sous la baguette d'André Cluytens (Emi) : cet
orgue qui résonne au début de l'acte IV, alors que
Marguerite (Victoria de Los Angeles) s'agenouille à
l'église pour prier, cet orgue qui soutient de sa «
clameur » tantôt les anathèmes lancés par
Méphistophélès (Boris Christoff), tantôt le « chant
pieux » du chœur, cet orgue qui, cette fois ne terrifie
plus mais rayonne en majesté pour l'apothéose
finale (« Christ est ressuscité ! »), c'est lui, c'est notre
glorieux fantôme !
Organiste : Henriette Puig-Roget
Source: Xavier Lebrun (facebook)/
www.diapasonmag.fr/histoire/le-vrai-fantome-de-l-
opera-32600

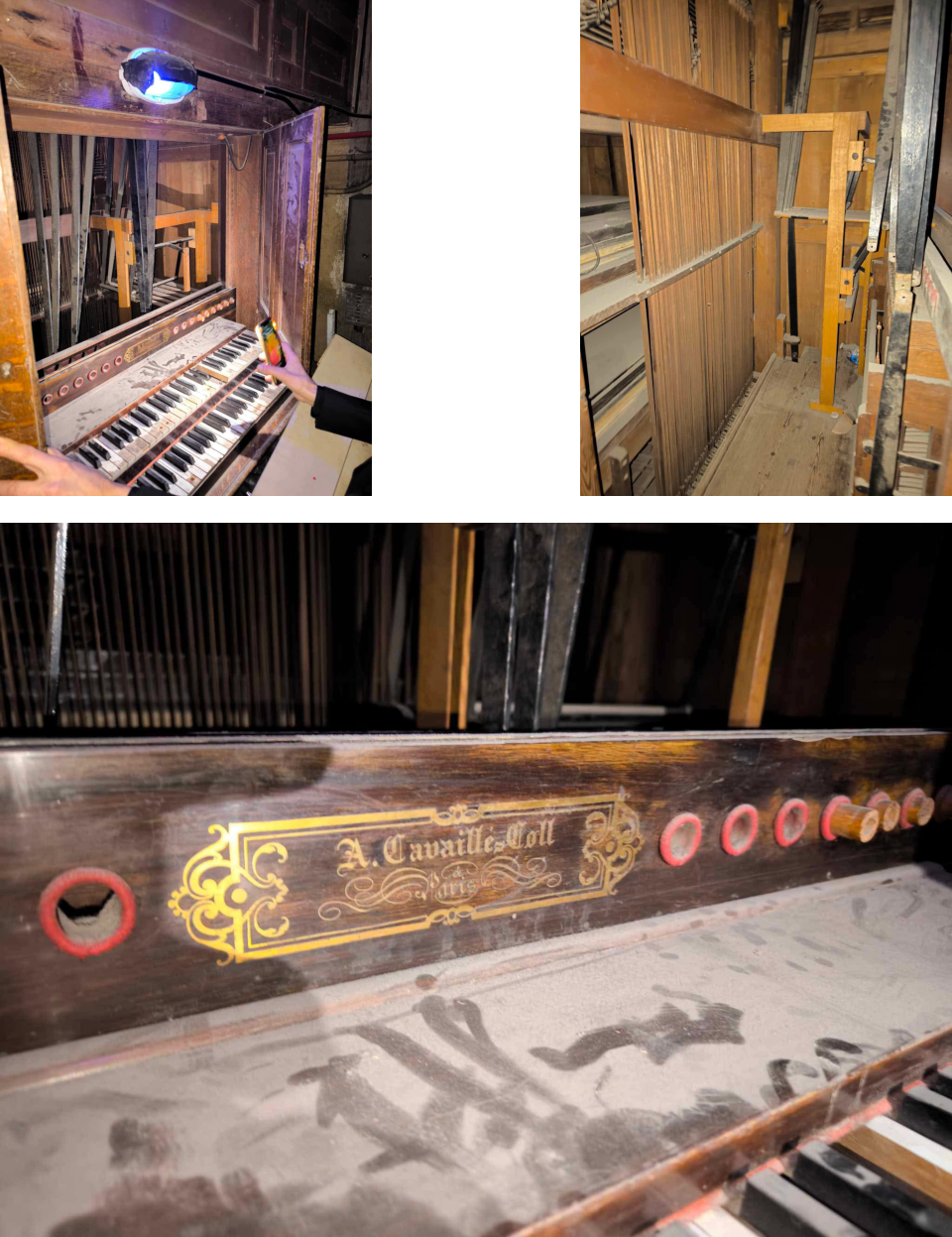
Les orgues de Paris
Opéra Garnier
Place de l'opéra, 75009 Paris
ORGUES DE PARIS © 2024 Vincent Hildebrandt LES ORGUES

E6
Beaucoup ignorent que l’Opéra de Paris possède un
instrument construit par Cavaillé-Coll en 1874.
Ce dernier est totalement invisible aux yeux du grand public
puisqu’il est situé côté Cour au niveau de l’avant-scène avec
des tuyaux à 12 mètres de hauteur.
Il s’agit d’un orgue de 14 jeux (sans compter 4 emprunts à la
pédale) répartis sur deux claviers de 56 notes et d’un
pédalier de 30 notes entièrement fermé dans une boite
expressive. L’inauguration a lieu le 8 janvier 1875 avec la
représentation de la « Juive » de Fromental Halévy. Dès ce
moment, l’orgue fut utilisé de façon régulière au gré des
représentations d’œuvres requérant son usage.
Cependant, l’instrument eu à souffrir rapidement de la
poussière provoquée par le montage des décors sur la scène
ainsi que des écarts de températures très grands. Un
premier cri d’alerte lancé en 1893 par Cavaillé-Coll lui-même
qui remarque que son instrument n’a jamais été
dépoussiéré. Par la suite, l’état de l’orgue se détériore
encore, certains jeux souffrent d’une perte de qualité de leur
timbre, si bien que Cavaillé considéra l’orgue « en état de
délabrement » en 1894! En 1925, suite à une fuite dans la
colonne d’eau du service incendie, l’orgue fut inondé et mis
hors de service. Suite à cet incident, la maison Cavaillé-Coll /
Convers fut appelée à effectuer une restauration de
l’instrument qui fut gratifiée de quelques modifications, a
plus importante étant l’installation d’ un ventilateur
électrique, installé dans une pièce séparée située sous
l’orgue.
Cet instrument fut utilisé pour la dernière fois le 23 mars
1959 pour célébrer le centenaire de la création de Faust par
Charles Gounod. Les claviers sont tenus par l'organiste
André Marchal. Il le joua encore occasionnellement en 1964.
Depuis 1974, l'orgue est devenu injouable et subit les
malversations visibles, surtout à la console. En revanche, la
tuyauterie d'origine subsiste intacte. Cet orgue est conservé
dans son emplacement d'origine voulu par son constructeur,
ce qui est unique dans son genre.
Informations de Timothy Tikker (facebook):
L’orgue était sur la pression du vent de 8’’ et 10’’, et je crois
l’orgue n’avait pas de levier pneumatique. Les fortes pressions
étaient principalement parce que l’orgue a été placé loin en
coulisses - les orgues de cinéma placés dans les coulisses ayant
aussi peu de rangs par rapport à la taille de la salle utilisaient
ces mêmes pressions. La console était située avec les tuyaux,
Cavaillé-Coll faisant remarquer que l’orgue a été conçu pour le
plaisir du public, pas de l’organiste! Le joueur pouvait voir le chef
d’orchestre à l’aide d’une série de miroirs soigneusement placés.
Il est question de sa restauration depuis 2012.
THE PARIS OPERA'S CAVAILLE-COLL ORGAN
Rollin Smith, The American organist
L’enregistrement
S'il est devenu injouable depuis 1974, une poignée
d'enregistrements en gardent la trace sonore. Le plus
célèbre d'entre eux est le Faust enregistré en 1953 sous la
baguette d'André Cluytens (Emi) : cet orgue qui résonne au
début de l'acte IV, alors que Marguerite (Victoria de Los
Angeles) s'agenouille à l'église pour prier, cet orgue qui
soutient de sa « clameur » tantôt les anathèmes lancés par
Méphistophélès (Boris Christoff), tantôt le « chant pieux »
du chœur, cet orgue qui, cette fois ne terrifie plus mais
rayonne en majesté pour l'apothéose finale (« Christ est
ressuscité ! »), c'est lui, c'est notre glorieux fantôme !
Organiste : Henriette Puig-Roget
Source: Xavier Lebrun (facebook)/
www.diapasonmag.fr/histoire/le-vrai-fantome-de-l-opera-
32600

























